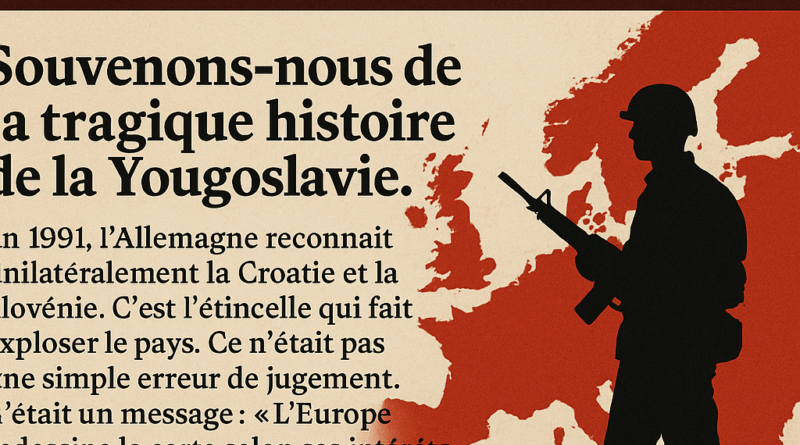Pourquoi la guerre est-elle de retour en Europe ?Démystifier le grand récit géopolitique
Pourquoi la guerre est-elle de retour en Europe ?Démystifier le grand récit géopolitique
« Poutine est un fou, un nouveau Hitler. L’OTAN est une alliance défensive et gentille. L’Europe est un projet de paix. L’Ukraine un pays démocratique et sans histoire… ».
Et si c’était un peu plus compliqué que cela, comme on aime à dire dans les milieux branchés de la communication ?
« L’UE est un projet de paix »
On nous répète que l’Europe est à la base un « projet de paix ». Pourtant son élargissement s’accompagne systématiquement de guerres à ses frontières. La Yougoslavie dans les années 1990, la Géorgie en 2008, et l’Ukraine depuis 2014. Simple coïncidence ?
Souvenons-nous de la tragique histoire de la Yougoslavie. En 1991, l’Allemagne reconnaît unilatéralement la Croatie et la Slovénie. C’est l’étincelle qui fait exploser le pays. Ce geste, présenté comme diplomatique, portait en réalité un message implicite : l’Europe redessinera la carte du continent selon ses propres intérêts. La guerre et son cortège d’atrocités fut le prix sanglant de cette décision.
Petit rappel des faits
1991, le bloc soviétique s’effondre. L’Amérique se retrouve seule sur le trône. Le « monde libre » n’a plus d’ennemi extérieur à sa mesure. Les États-Unis deviennent la seule superpuissance mondiale, forte d’une armée imbattable et d’un modèle économique triomphant : le libéralisme. Leur objectif ? Profiter de cette fenêtre d’opportunité unique pour étendre leur zone d’influence le plus loin possible, le plus vite possible, en avançant sur deux fronts : L’OTAN et L’UE.
Créée en 1949 pour contenir l’URSS, l’Alliance atlantique ne cesse de s’étendre vers l’Est. En 1999, elle intègre la Pologne, la Hongrie et la République tchèque, d’anciens membres du Pacte de Varsovie, le camp ennemi d’hier. En 2004, c’est la boulimie. Elle engloutit trois anciennes républiques soviétiques : l’Estonie, la Lettonie, et la Lituanie.
En parallèle, l’Union Européenne étend son marché et déverse ses générosités aux dits pays… tout en accroissant son influence politique afin d’ancrer pour toujours ces nations dans le bloc occidental.
On pourrait bien sûr objecter que cet élargissement a aussi apporté stabilité et prospérité à de nombreux États d’Europe centrale et orientale. C’est vrai. Mais cette stabilité s’est payée au prix d’une dépendance économique et politique croissante, transformant ces pays en zones tampons plus qu’en partenaires égaux.
Où est le problème me direz-vous ?
Le problème ? C’est qu’en toute logique, cette double expansion ne peut être vécue par Moscou que comme un encerclement stratégique, car elle se fait au détriment de ses intérêts de sécurité. Les dirigeants russes, de Eltsine à Poutine ont assisté quasiment à leurs portes, au déploiement de ce qu’ils considèrent comme une alliance hostile orchestrée par leur rival historique.
La construction européenne ne renvoie ainsi pas l’image d’un simple projet de paix désintéressé. Elle opère visiblement une avancée géopolitique globale. Et les guerres que nous voyons aujourd’hui sont, en grande partie, les contre-coups prévisibles de cette expansion. Sans compter que l’on souhaite, à l’horizon 2030, élargir l’UE de 27 à 36 membres !
Encercler la Russie afin de l’affaiblir
L’élargissement de l’UE et de l’OTAN, n’est donc pas une banale « invitation » à un bal européen, mais bien une avancée stratégique.
On nous présente l’UE comme l’union naturelle des nations européennes. Pourtant, la Russie, puissance historique du continent, en est systématiquement tenue à l’écart. Pourquoi ?
La réponse est simple, mais elle heurte le narratif officiel. L’UE n’est pas un club universaliste ; c’est un club atlantiste. Son ADN, forgé pendant la Guerre Froide, est structurellement antisoviétique.
Il faut se souvenir d’une chose que nous avons peut-être tendance à vouloir oublier : pour l’impérialisme occidental, la « menace rouge » n’a jamais disparu. Elle a changé de forme.
Hier, c’était le communisme soviétique qui menaçait par son modèle économique (le collectivisme), son projet politique (le pouvoir soviétique) et son ambition idéologique (l’internationalisme prolétarien) ; contestant radicalement la légitimité du capitalisme libéral.
Aujourd’hui, la Russie de Poutine, même si elle n’est plus communiste, incarne toujours ce même danger stratégique : c’est une puissance eurasiatique qui refuse de se soumettre à l’ordre unipolaire américain. Elle défend un modèle de souveraineté nationale forte, une vision du monde multipolaire et un contrôle étatique sur les secteurs stratégiques de son économie.
Intégrer la Russie dans l’UE aurait été un suicide géopolitique pour le projet atlantiste.
L’introduisant d’un rival géopolitique au cœur même de l’Union aurait dillué l’alliance transatlantique. Cela aurait créé un contre-pouvoir interne capable de bloquer les politiques de sanctions, de s’opposer à l’élargissement de l’OTAN et à même de défendre des intérêts économiques et énergétiques divergents. Cela aurait légitimé un modèle alternatif à l’intérieur même de la « forteresse libérale », rendant impossible l’homogénéisation politique et économique galopante de l’Europe.
L’UE n’est donc pas la « Maison de l’Europe ». C’est une construction conçue pour ancrer fermement le continent dans l’orbite politique, économique et militaire des États-Unis. L’exclusion de la Russie n’est pas un oubli : elle est la condition même de l’existence du projet.
La « menace rouge », sous une forme nouvelle, reste le ciment qui soude le bloc atlantiste. Et qui justifie son expansion et son unification contre un ennemi commun désigné.
« Poutine est un fou agressif et imprévisible ». Est-ce aussi simple ?
Le récit dominant nous présente Poutine comme un dictateur irrationnel, mû par une soif de pouvoir sans limite. Mais si cette vision, en plus d’être simpliste, nous empêchait de comprendre les véritables ressorts de ce conflit ? Et si l’invasion de l’Ukraine, aussi condamnable et illégale soit-elle, était aussi la conséquence prévisible de 30 ans de provocations stratégiques occidentales ?
Il est crucial de préciser un point fondamental : comprendre n’est pas excuser. Analyser les racines géopolitiques d’un conflit ne revient en aucun cas à absoudre les crimes de guerre ou la nature autoritaire dudit régime. Il s’agit de refuser le manichéisme pour apporter des éléments objectifs et historiques.
Pour cela, il faudrait peut-être comprendre ce que l’on pourrait appeler « le prisme mémoriel russe », souvent ignoré en Occident.

Le prisme mémoriel de la Russie : une histoire qui ne passe pas
En Russie, La Seconde Guerre mondiale est appellée la « Grande Guerre Patriotique » ; un traumatisme fondateur et le récit national le plus puissant.
Les récits réducteurs des manuels scolaires qui font du débarquement américain et de l’armée US, le bras libérateur sont partiels et partials.
Rappelons des chiffres qui eux ne mentent pas. La seconde guerre mondiale c’est 30 millions de morts soviétiques dans des batailles devenues le symbole d’un sacrifice absolu. Stalingrad (près de 2 millions de victimes), Leningrad assiégée pendant 872 jours (plus d’un million de morts, principalement de faim). Dont des milliers de jeunes élèves-officiers de l’école militaire.
Le Department of Veterans Affairs des États-Unis, référence officielle pour les statistiques a déclaré le nombre total de 405 399 morts. 291 557 morts au combat et 113 842 morts hors combat (maladies, accidents, etc.)
Face aux récits partiels, retrouver la mémoire et la mesure
C’est par ce sacrifice de l’ex URSS que l’Europe a été sauvée du nazisme. Et cela les russes ne l’oublient pas, contrairement à beaucoup d’européens. Or cette mémoire est cruciale pour décrypter la psyché politique russe actuelle.
Lorsque l’Occident célèbre le débarquement en Normandie comme l’événement décisif, il occulte, aux yeux des Russes, leur contribution essentielle et le prix inimaginable payé. Cette « dette mémorielle » ne peut que nourrir un profond ressentiment.
Après un tel sacrifice pour vaincre le nazisme dont on rappelle qu’il s’agit d’une menace venue de l’Ouest, la Russie postsoviétique a vu se construire à ses portes, sous leadership américain, la plus grande alliance militaire de l’histoire : l’OTAN.
De la mémoire au conflit : les leçons ignorées de l’Histoire
Historiquement, l’Ukraine fut le théâtre des plus terribles batailles contre les nazis. Que l’Occident souhaite y étendre son influence ne peut être considéré comme une simple manœuvre géopolitique.
Encore une fois, cela ne justifie en rien l’invasion de 2022. Mais cela éclaire la logique de Moscou qui s’appuie sur une mémoire collective réelle et douloureuse, que l’Occident a largement ignorée.
En ne prenant pas en compte ce traumatisme fondateur et les avertissements stratégiques qui ont suivi, les puissances occidentales ont contribué à créer le terreau explosif sur lequel la guerre a pu éclater.
« Nous soutenons l’Ukraine démocratique contre la dictature ». Et c’est tout ?
Pourquoi les médias et les gouvernements européens parlent-ils si peu des bataillons d’extrême-droite en Ukraine, comme le régiment Azov ? Parce qu’encore une fois cela troublerait le récit du « gentil contre le méchant ».
Ces groupes, qui vénèrent des collaborateurs nazis de la Seconde Guerre mondiale, ont été intégrés dans la Garde Nationale ukrainienne. Ils ont joué un rôle clé dans la guerre du Donbass après 2014. Des rapports documentent les exactions.
En Europe de l’Ouest, l’extrême-droite est diabolisée car elle est parfois pro-Poutine et menace l’unité atlantiste. En revanche, en Ukraine, la même extrême-droite est instrumentalisée car elle se bat farouchement contre les Russes. C’est la règle d’or de la géopolitique : « L’ennemi de mon ennemi est mon ami », même s’il est néo-fasciste.
« L’Allemagne se réarme à cause de Poutine ». Vraiment ?
On nous explique que le réarmement historique de l’Allemagne est une simple réaction défensive à l’agression russe. Peut-on sérieusement croire que les États-Unis et leurs alliés, qui n’ont pas hésité à bombarder l’Irak en 2003 sur la base de fausses preuves (des « armes de destruction massive »), réarmeraient la quatrième puissance mondiale issue du IIIe Reich sur la base d’une « crainte » ? Qui pense-t-on convaincre avec de tels non-arguments ?
La « menace russe » fonctionne en réalité comme une opportunité géopolitique inespérée pour concrétiser des objectifs stratégiques de long terme.
Après 1945, l’Allemagne était devenue une anomalie : un géant économique et un nain militaire, contrainte par un pacifisme constitutionnel. Cette situation convenait à ses voisins, mais limitait son influence réelle.
Le « virage historique » annoncé par Olaf Scholz n’est pas qu’une réponse à la Russie. C’est l’acte de naissance officiel de l’Allemagne comme puissance militaire normalisée, brisant le dernier tabou de l’après-guerre.
Pourquoi Washington pousse-t-il à ce réarmement ?
Une Allemagne réarmée, mais intégrée à l’OTAN, est une Allemagne dont la puissance militaire reste sous supervision américaine. Quant à la Chine, elle est désormais considérée par les États-Unis comme leur principal rival. Ils ont besoin d’une Europe plus forte militairement pour porter une partie du fardeau. Une Allemagne réarmée est destinée à être le leader militaire de l’Europe dans ce nouveau jeu, sous commandement américain.
Désormais, on ne dira plus « l’Allemagne paye », mais « l’Allemagne arme et protège » !
Berlin n’est pas, on s’en doute, une victime passive de ce calcul. Elle y trouve bien évidemment son compte en consolidant son leadership économique et en le doublant d’une influence stratégique. D’où son poids manifeste dans toutes les négociations européennes.
Réarmer l’Allemagne par simple crainte de la Russie n’est pas crédible. La réarmer pour en faire le fer de lance d’un bloc occidental consolidé face à la Chine et pour achever la « normalisation » de sa puissance, cela l’est beaucoup plus.
La « menace russe » devient le prétexte parfait, le catalyseur qui rend politiquement acceptable l’inacceptable. Il est stratégiquement commode pour tout le monde (Washington, Berlin, l’industrie de l’armement) de brandir le spectre de Poutine pour justifier un rééquilibrage des puissances qui sert des intérêts bien plus larges et durables. La guerre en Ukraine semble avoir offert une fenêtre d’opportunité pour réaliser ce qui était dans les cartons depuis des années.
Pourquoi l’Allemagne plutôt que la France ?
Pourquoi n’a-t-on pas eu peur de la réaction de l’opinion internationale face au réarmement de l’Allemagne ? Il est en effet plus qu’étrange que ce réarmement ne suscite pas de réactions aussi bien au niveau de l’opinion publique que des médias.
L’argent a ses raisons que la raison ignore. Il se trouve que c’est l’Allemagne et non la France qui est la première puissance économique d’Europe et la quatrième mondiale. Son budget, sa capacité d’emprunt et sa masse financière sont sans équivalent sur le continent. Un réarmement se paye. La capacité de Berlin à débloquer 100 milliards d’euros d’un coup est un signal que seule l’Allemagne peut envoyer. La France n’a pas cette capacité de leviers financiers.
Par ailleurs, l’Allemagne est au centre de l’Europe. Elle partage une frontière directe et une histoire profondément imbriquée avec l’Europe centrale et orientale (Pologne, pays baltes, Tchéquie). C’est la puissance « naturelle » pour projeter sa force et servir de base arrière logistique en cas de conflit à l’Est. La France a une position géographique trop périphérique.
Ironiquement, c’est l’Allemagne qui a représenté un danger dans le passé, qu’il est stratégique aujourd’hui de réarmer. L’Allemagne réunifiée, avec son poids économique, sa position centrale et son ancrage atlantiste est devenue la candidate parfaite pour être le « bras armé » de l’Europe. Le rôle pour l’Allemagne, est désormais d’être le géant militaire sous le parapluie et le contrôle de l’OTAN.
Alors, qu’est-ce qui se joue vraiment ?
On nous a vendu la « Fin de l’Histoire » et l’idée qu’après 1989, le monde allait converger pacifiquement vers la démocratie libérale.
La réalité, c’est que l’Histoire est de retour, et avec elle, la vieille logique des empires, des sphères d’influence et des rapports de force. La Yougoslavie nous avait tragiquement prévenus. L’Ukraine nous le confirme.
Et pour ceux qui douteraient encore que les intérêts économiques priment sur les grands principes, regardez vers la Chine. Pourquoi les panneaux d’alerte en Europe annoncent-ils une « menace chinoise » bien plus souvent qu’ils ne dénoncent la menace fasciste à l’intérieur de nos frontières ?
Pourtant la Chine ne remet pas en cause l’ordre politique en Europe. Elle ne finance pas de partis pro-Pékin pour prendre le pouvoir à Bruxelles ou Paris. Sa « menace » est d’un autre ordre, bien plus fondamentale pour le système : elle remet en cause la domination économique et technologique de l’Occident.
Un parti néo-fasciste en Europe, même au pouvoir, ne menace pas Apple, Tesla ou Airbus. Il défend un capitalisme national, souvent très dur, mais qui reste dans le cadre.
La Chine construit ses propres Apple (Huawei), ses propres Tesla (BYD) et ses propres Airbus (COMAC). Et elle a pour ambition de dominer les industries du futur. Elle représente en cela, le premier concurrent systémique que l’Occident ait connu depuis la fin de l’URSS.
Le message est limpide
Vous pouvez être un régime autoritaire, réprimer les libertés, avoir un parti unique ou fasciste… si vous restez un atelier low-cost et un marché captif pour nos produits, on peut faire affaire. Mais si vous rivalisez avec nous sur les technologies de pointe et que vous contestez notre leadership économique, alors vous devenez la « menace numéro un ». Cette logique expliquerait l’étrange tolérance européenne vis-à-vis de la montée de l’extrême-droite chez elle.
Faut-il y voir de l’inconscience ou de l’amnésie ?
Non, l’Europe ne fait pas preuve d’inconscience, mais d’une hypocrisie stratégique qui bascule dans la complicité objective.
Le « Plus jamais ça » d’après la deuxième guerre est un pilier mémoriel, mais pas un principe politique absolu. Il est brandi contre les ennemis extérieurs, mais esquivé à l’intérieur, où l’extrême-droite sert de « valve de sécurité », en canalisant la colère sociale vers des boucs émissaires tout désignés (l’immigré, l’islam, le RMIste …). Ce qiui détourne l’attention des véritables causes, notamment le modèle économique néolibéral inégalitaire.
Cette « fascisation » lente n’est pas un accident ; elle est instrumentalisée. Elle fournit l’idéologie qui divise les populations et empêche l’émergence d’une contestation unie sur des bases d’une justice sociale.
Une extrême-droite au pouvoir est perçue comme gérable, car elle ne remet pas en cause les fondamentaux du capitalisme. Une victoire de forces antisystème de gauche ou d’extrême-gauche, qui s’attaquerait aux traités européens et à l’OTAN, serait une menace bien plus grave pour l’establishment.
La priorité est donc claire : la préservation de l’hégémonie économique capitaliste libérale au détriment même de la défense des principes démocratiques.
Quand la force se substitue au droit
Les beaux discours sur les valeurs de la « démocratie » servent de paravent à des intérêts géostratégiques et économiques bien concrets. C’est pourquoi il est indispensable de restituer la profondeur historique des événements. Car l’amnésie historique ouvre la voie à des récits épurés qui servent des intérêts politiques peu glorieux.
Une histoire réduite à un récit commode ne permet pas d’éclairer les enjeux ; elle les obscurcit et devient, à terme, un instrument dangereux au service de légitimations unilatérales. Comprendre cela, ce n’est pas excuser les agissements d’x ou d’y. C’est refuser la simplicité trompeuse du « Bien contre le Mal ». C’est accepter que le monde le monde est un enchevêtrement d’intérêts stratégiques où la morale est souvent un instrument au service de la raison d’État.
La paix ne viendra surement pas en diabolisant l’autre camp, mais en comprenant au-delà des discours médiatiques, les raisons profondes de cet affrontement. Opposer une amnésie commode à un récit partial est une impasse. Peut-etre est-ce en affrontant la complexité du passé que l’on cesse de répéter ses erreurs. Et cela commence par se poser les bonnes questions.