Banque halal et Banque éthique : l’oxymore d’un capitalisme non assumé ?
Banque halal ou éthique : Entre Oxymore et Illusion Marketing
Le syntagme même de « banque éthique » a quelque chose de scandaleux. C’est comme parler d’« usure vertueuse » ou de « profit désintéressé ».
Le mot « banque » évoque souvent dans l’inconscient collectif : la spéculation, la dette, l’intérêt, en un mot, la mécanique froide d’un capital sans âme qui se nourrit du vrai travail. Le mot « éthique » convoque au contraire la conscience, la justice, et la mesure.
Les associer, c’est juxtaposer deux mondes rendus incompatibles par les principes régulateurs de l’économie capitaliste : la morale et le marché.
Pourtant, surfant sur la moralisation forcée des secteurs les plus improbables, la mode de la finance éthique a gagné du terrain. Et dans son sillage, certains revendiquent une banque éthiquement islamique, autrement dit, qui échappe à l’usure (riba) et à la spéculation (gharar).
Banque ou service de paiement ? Le premier malentendu
Mais derrière cette aspiration plus que légitime se cache une réalité bien triviale : il n’existe pas, à proprement parler, de banque de détail islamique en France.
Quelques établissements comme la Chaabi Bank ou certaines filiales de groupes français proposent des produits conformes à la finance islamique, mais aucune institution n’opère intégralement selon ce modèle.
Au niveau de l’Europe, quelques banques comme KT Bank en Allemagne ou Al Rayan Bank au Royaume-Uni fonctionnent réellement selon ces principes, avec quelques exceptions marginales au Royaume-Uni ou au Luxembourg.
Le reste ? Et bien il s’agit, pour l’essentiel, d’établissements de paiement qui utilisent le terme « banque » comme un marqueur marketing plus que comme une réalité institutionnelle. Mais ce ne sont pas des banques.
Commençons donc par clarifier un abus de langage.
Une banque — BNP, LCL, Société Générale, Banque Postale… — détient un agrément qui lui permet de collecter des dépôts, de créditer, et de placer des fonds.
Les services dits alternatifs, type : Revolut, N26, Nickel, Musc Pay, Laymoon, etc… sont de simples établissements de paiement : un statut intermédiaire qui leur interdit d’octroyer des crédits ou de transformer les dépôts.
Ces « banques » peuvent certes conserver temporairement les fonds des clients sur des comptes de cantonnement ouverts dans des banques partenaires. Mais ces sommes ne sont pas considérées comme de véritables dépôts bancaires.
Dès lors, présenter ces services comme une « alternative » relève de la tromperie sémantique. Ils ne sont pas une échappatoire au système bancaire, mais son prolongement numérique. Une façade technologique branchée sur le même circuit.
L’illusion d’indépendance : la symbiose invisible avec le système bancaire
La dépendance de ces néo-banques à l’égard du système classique est totale : structurelle, réglementaire, fonctionnelle. Pour au moins trois raisons :
- Les fonds des clients sont déposés sur des comptes de cantonnement tenus par des banques agréées. Autrement dit, c’est toujours le système bancaire traditionnel qui en assure la garde et la traçabilité. Même si juridiquement, les fonds restent la propriété du client.
- Les virements SEPA, les cartes Visa ou Mastercard, les chambres de compensation : tout passe par les artères du système bancaire global. Sans ces circuits, aucune transaction n’existe.
- Les dépôts de chèques, les retraits d’espèces, l’octroi de crédits : tout dépend du réseau et des partenariats des grandes banques.
Pour utiliser une image : les banques traditionnelles sont les câbles électriques dissimulés dans le mur ; les néo-banques, de simples prises design. Sans le courant, elles ne sont rien.
On pourrait dire la même chose des opérateurs téléphoniques dits « alternatifs », qui utilisent en réalité le réseau de Bouygues ou d’Orange : ils changent l’emballage, pas l’infrastructure.
Finance « éthique » ou mirage moral ?
Certains acteurs surfent sur la soif de cohérence morale qui gagne nos sociétés et déclarent : « Nous ne spéculons pas avec votre argent. » « Une finance 100 % sans intérêt. » « Vos dépôts sont éthiques et garantis. » Mais ces promesses sont techniquement intenables. Car l’argent circule. Et, en vertu de la loi, il est déposé dans une « vraie » banque.
Nous ne nions pas que ces promesses puissent être tenues au niveau des produits proposés au client (pas de prêt à intérêt, mais de la Moudaraba, Moucharaka, etc.). Cependant, elles s’étendent de manière fallacieuse à l’ensemble de l’écosystème, laissant croire que l’établissement lui-même fonctionne en dehors de tout système à intérêt. Ce qui est techniquement impossible, pour les raisons de dépendance bancaire expliquées plus haut.
Dit autrement, une néobanque délègue à une institution classique l’activité même qu’elle prétend refuser. Elle s’appuie sur la solidité du système bancaire classique, sans toutefois relever directement du mécanisme de garantie des dépôts, réservé aux établissements agréés.
L’impossible pureté
La protection des fonds passe ici par un cantonnement ou une assurance spécifique, adossés à des institutions traditionnelles. Se dire « hors du système » tout en profitant de sa protection, c’est la quadrature du cercle moral. La seule affirmation honnête serait : « Nous ne spéculons pas directement avec votre argent, mais nos partenaires, eux, le font. »
De la même façon, et pour ne pas donner l’impression d’une attaque sans discernement, il me faut considérer qu’il est parfaitement compréhensible dans un système bancaire aujourd’hui incontournable, de vouloir confier son argent à des institutions dont les dirigeants partagent vos valeurs.
Ceci étant dit, cette démarche devrait être envisagée comme une solution provisoire, une forme de compromis lucide, et non comme une fin en soi. S’en satisfaire reviendrait à se bercer d’une illusion de cohérence dans un cadre qui, rappelons-le, demeure structurellement contraire aux principes qu’il prétend incarner.
L’éthique n’est pas une posture, mais une architecture
L’erreur majeure consiste à croire que la moralité d’un système dépend de la foi de ceux qui le dirigent. Or, un dirigeant pieux ne rend pas une institution vertueuse si les mécanismes qu’elle utilise sont ceux du capitalisme usuraire. L’éthique, en matière financière, ne réside pas dans la barbe du PDG, ni dans le contenu des slogans, mais dans la structure juridique et économique du modèle. Tant que ces institutions s’adosseront à des banques conventionnelles pour exister, elles seront prisonnières du même paradigme.
L’enjeu n’est donc pas de trouver une « banque » dirigée par des musulmans, mais de concevoir un système monétaire alternatif fondé sur des règles conformes à cette éthique. Tout le reste ( interfaces, applications, slogans, discours sur la transparence) relève du théâtre moral du capitalisme tardif.
La banque : institution morale ou structure a-morale ?
Jusqu’ici, notre analyse s’est placée dans le cadre du système tel qu’il est. Nous avons questionné la possibilité d’une banque « morale » à l’intérieur du capitalisme, sans oser formuler la question première : la notion même de banque n’est-elle pas, ontologiquement, liée à la logique capitaliste ? Autrement dit, peut-on vraiment penser la banque autrement que comme un instrument du capital, comme faisant partie en quelque sorte de son code génétique ?
La banque, dans son principe le plus nu, repose sur une opération apparemment simple mais philosophiquement redoutable : faire de l’argent avec de l’argent. Ce que les Anciens appelaient la chrématistique : l’art d’accumuler la richesse pour elle-même. Par opposition à l’économie, au sens étymologique : la gestion des biens nécessaires à la vie.
Que l’argent puisse générer davantage d’argent sans travail ni production réelle, c’est pour un philosophe comme Aristote, une perversion du rapport au monde. La banque moderne ne fait qu’institutionnaliser cette stérilité féconde.
L’argent qui enfante l’argent : une logique contre-nature
Dans ce sens, on pourrait dire que la banque n’est pas immorale, mais a-morale dans la mesure où elle obéit à une logique autonome, indifférente au bien et au mal; son unique horizon étant, non pas la vertu mais la rentabilité crue. La moralité devient le correctif cosmétique d’une structure dont le moteur reste la transformation non pas de la force de travail en richesse, mais de l’argent en plus d’argent.
Une banque pourra indifféremment financer un projet 100% écologique, ou une guerre génocidaire. La valeur initiale c’est l’argent et la valeur finale c’est encore l’argent, peu importe le terme médian.
La directive européenne qui interdira dès novembre 2026 le découvert bancaire illustre parfaitement cette dérive technocratique : l’outil, jadis pensé comme un amortisseur social, est dorénavant perçu comme une anomalie comptable.
Il ne s’agit pas ici d’accuser les individus ou millions de citoyens qui tentent de sauver leur minuscule épargne ou de financer leur modeste foyer. Le problème n’est pas moralement personnel mais structurel. Il s’agit de nous interroger sur notre rapport à la banque elle-même : non pas sur quelle banque choisir, mais sur la possibilité même d’un monde sans banques.
Vers une critique ontologique de la banque
Il nous faut admettre une chose : l’institution bancaire, dans son essence, est indissociable du capitalisme. Son existence suppose que l’argent ne soit plus un moyen mais une fin, et que le crédit devienne le sang vital d’une économie fondée sur la dette. Dès lors, réformer la banque sans repenser le capitalisme revient à vouloir moraliser la flamme sans toucher au feu.
La finance islamique, souvent citée en contre-modèle, ne se contente pas d’interdire le riba (l’intérêt) : elle proscrit aussi la gharar (la spéculation) et le haram (l’illicite). Les trois interdictions fondamentales sont : l’intérêt, qui fait de l’argent un produit ; la spéculation, qui dissocie le profit du réel ; et l’illicite, qui soumet le gain à une exigence de conformité morale.
Et, il propose en contrepartie, deux obligations structurantes : le partage des profits et des pertes en tant que principe de justice et de responsabilité mutuelle, et l’adossement à un actif tangible, afin que toute transaction soit enracinée dans une réalité matérielle et non dans l’abstraction de la dette.
Mais là encore, la contradiction demeure : tant que ces principes se déploient dans un environnement global régi par le capitalisme financier, ils ne peuvent que cohabiter, jamais s’imposer.
Peut-on imaginer une société sans banques ?
La question paraît folle, mais elle ne l’est pas plus que celle que certains se sont posés en essayant de penser une société sans école ? Dire cela ne revient pas à nier les apports de l’institution scolaire qui a permis à des millions d’enfants d’accéder à une instruction de base, mais à constater la dérive totalitaire d’un système devenu obligatoire de fait.
Déscolariser un enfant n’est plus un choix, mais une transgression. De même, vivre sans banque est devenu quasiment illégal. Nos sociétés ont transformé l’usage en dogme, la commodité en obligation. Et nous ne savons plus penser hors du cadre. Nous ne concevons plus d’existence sans compte, sans carte, sans identifiant bancaire, comme s’il était devenu impensable de vivre sans médiation financière, comme il est devenu suspect d’apprendre hors de l’école.
David Graeber, dans Dette, 5000 ans d’histoire, brisait déjà une illusion fondatrice : celle d’un troc primitif qui aurait conduit à la monnaie. Renversant ce mythe il explique que la dette a précédé la monnaie, et que la monnaie fut inventée pour l’administrer.
De la même façon, ce n’est pas parce que nous ne savions plus où mettre notre argent qu’un banquier bienveillant nous a proposé de le garder. C’est parce qu’un système s’est institué pour contrôler l’argent que nous avons fini par lui confier le nôtre.
La banque, condition d’existence
Le plus inquiétant n’est pas que la banque existe, mais qu’il soit devenu interdit de ne pas y recourir. Le scandale n’est pas l’usage, mais l’impossibilité de s’en affranchir. C’est cela, le fascisme doux du monde moderne.
Les directives européennes, les dispositifs administratifs, les obligations bancaires et scolaires participent d’un même glissement insidieux : une uniformisation silencieuse des modes de vie, un quadrillage des consciences sous couvert de rationalité économique et de sécurité collective. Ainsi, la banque n’est plus seulement un outil, mais une condition d’existence.
Bâqir al-Sadr et la morale du crédit
Cette tension entre l’éthique et la structure n’a rien de nouveau. Après les travaux théoriques fondateurs de Sayyid Abul A’la Maududi, et les premières expérimentations pratiques comme celle d’Ahmad Elnaggar avec la caisse d’épargne de Mit Ghamr en Égypte au début des années 1960, l’un des penseurs à l’avoir formulée de la manière la plus systématique fut Muhammad Bâqir al-Sadr, auteur de : »Iqtisaduna » (Notre Économie, 1961), connu en français sous le titre « La Banque sans intérêt en Islam ».
Al-Sadr ne renverse pas la banque mais la purifie. Il conserve l’institution, mais lui retire son moteur usuraire, espérant qu’elle puisse encore fonctionner sans l’essence du capitalisme. Il moralise la mécanique sans la réinventer. Cette tentative reste pourtant précieuse. Elle rappelle qu’une alternative véritable ne naîtra pas d’un lexique pieux ou d’un vernis éthique, mais d’une autre architecture du crédit, du temps et de la valeur.
Par ailleurs, et en dehors du cadre islamique, d’autres penseurs ont cherché, souvent dans l’indifférence générale, à concevoir une économie libérée de la rente. Et toutes ces tentatives témoignent à l’unisson d’une même intuition : tant que l’argent produit de l’argent par lui-même, aucune éthique ne peut tenir.
L’exception iranienne : une architecture distincte
Si le Soudan, à une époque, ou encore le Pakistan et la Malaisie aujourd’hui, ont tenté d’institutionnaliser une finance islamique, un seul pays peut véritablement revendiquer d’en avoir fait le fondement intégral de son système économique, c’est l’Iran.
L’Iran a institutionnalisé une finance islamique intégrale depuis la Révolution de 1979. L’ensemble du système bancaire y fonctionne sans intérêt ; les contrats reposent sur le partage du risque et du profit (Moudaraba, Moucharaka, etc.) ; et l’État en contrôle la conformité religieuse et morale. Ce dispositif ne cherche pas à rendre la finance islamique « compatible » avec le capitalisme, mais à la placer en marge de celui-ci.
Il ne s’agit donc pas d’une simple « banque éthique » insérée dans le marché global, mais d’un système monétaire et idéologique autonome, adossé à une souveraineté politique et spirituelle qui en définit les règles.
Ce que prouve l’exemple iranien, c’est qu’une économie réellement éthique doit sortir de l’écosystème capitaliste pour exister. La banque éthique n’est possible qu’à la condition de rompre avec la logique de la rente, de la dette et du profit illimité.
L’exterritorialité comme condition de l’éthique
Certains pourraient objecter : Oui, certes la finance islamique fonctionne mais au prix d’un isolement partiel du système financier mondial ! Effectivement, le système bancaire iranien est structurellement exclu du réseau global au sens où il n’est pas intégré au système SWIFT et qu’il ne participe pas librement au marché des capitaux internationaux ;
L’Iran n’est pas une enclave vertueuse dans le marché, mais un système autonome, traversé de contradictions internes, certes, mais fidèle à sa cohérence ontologique.
L’Iran prouve qu’une finance éthique est possible, mais seulement au prix d’une sortie du capitalisme. La Malaisie prouve qu’une finance éthique est acceptable, mais seulement au prix d’une reddition à ses codes. Entre ces deux extrêmes, la rupture et l’assimilation, se joue aujourd’hui tout l’avenir du mot “éthique” dans la sphère financière.
Une éthique à crédit !?
La « banque éthique » (et a fortiori islamique) reste dépendante du système capitaliste et donc moralement compromise. Le modernisme a réussi une prouesse : rendre le compte bancaire quasi obligatoire pour exister socialement.
Certes, la loi reconnaît un « droit au compte », mais dans les faits, l’absence de compte vous condamne à l’invisibilité administrative : un bannissement discret mais total de la sphère économique. Celui qui n’en a pas devient un marginal administratif, un exclu de la machine à vivre. Ainsi, même ceux qui rejettent l’usure sont contraints de l’utiliser.
Et nous voilà donc réduits à chercher des formes d’« éthique compatible », des fictions morales pour apaiser nos consciences dans un système qui, par essence, les dévore.
Le désir des usagers est légitime. Mais la réalité technique du monde financier est plus forte. Elle broie et dévore tout ce qu’elle touche. Et pour l’heure, la « banque éthique » dans les systèmes capitalistes n’est pas une révolution mais la dernière invention du marché pour vendre la vertu à crédit.

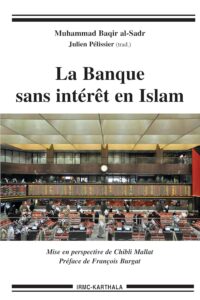
Très enrichissante analyse.
L’uniformisation globale efface les singularités, marginalise la morale et les croyances. Ne sommes nous pas nous-même des variables dans les équations écrites par ceux qui dominent le monde actuel ? Et je dis bien « des variables », pas « des inconnues ».
Nous avons eu les hippies dans les années 60. Verrons nous la naissance d’une nouvelle forme de rejet de cette forme de mise en boîte, d’uniformisation des individus ?
Que Dieu nous éclaire et nous préserve.