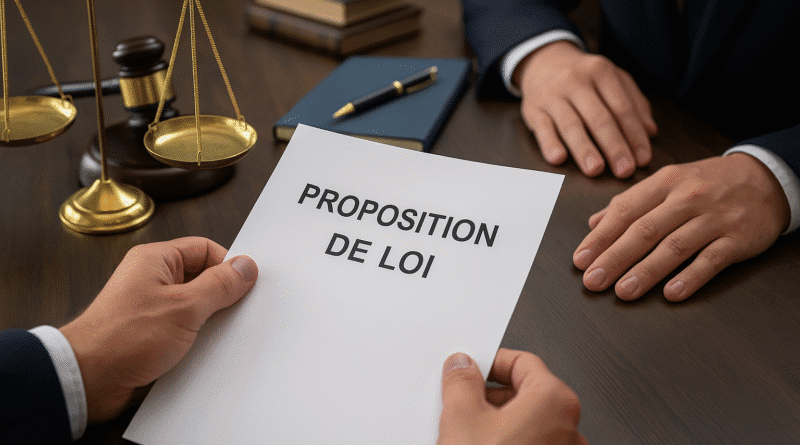Voile, lois et exclusions : quand la République oublie ses principes
Hier,
Hier, c’était la loi du 15 mars 2004. Sous couvert de neutralité et de respect du principe de laïcité, cette loi a interdit à des jeunes filles musulmanes le port du voile dans les établissements scolaires publics. Ce texte, présenté comme une réponse juridique à un problème de cohésion sociale, a surtout ouvert la voie à des interprétations abusives et à des dérives manifestes : exclusions de centres de formation, refus d’accès à l’emploi, discriminations dans les services publics, interrogatoires lors des entretiens d’embauche sur les pratiques religieuses… Un glissement s’est opéré, insidieusement, de la neutralité institutionnelle à la suspicion généralisée envers une partie de la population.
En 2008, la pétition « Un cri contre le racisme et l’intégrisme », lancée par Caroline Fourest, Corinne Lepage et Pierre Cassen, prétendait défendre l’universalisme républicain. Mais son ton et sa cible trahissaient une intention bien plus polémique : désigner implicitement, voire explicitement, les musulmans comme une menace. La même logique animait la campagne « halteauvoile », qui confondait revendication identitaire avec engagement pour les droits humains, contribuant ainsi à banaliser l’islamophobie dans l’espace public.
En 2009, une nouvelle étape est franchie avec la proposition de résolution du député André Gérin visant à créer une commission d’enquête parlementaire sur le port du voile intégral. Très vite, 58 députés signent le texte, toutes tendances confondues. Ce consensus politique autour d’une posture sécuritaire et stigmatisante révèle une chose : le débat n’est plus juridique, mais civilisationnel. Le niqab, bien que marginal en France, devient le symbole d’un « problème » à éradiquer, dans un climat de peur entretenu par des récits médiatiques sensationnalistes.
L’arsenal législatif s’alourdit : la loi Hostalier (proposition 1080) veut interdire le voile dans l’espace public. Les propositions 1061 et 3056 s’attaquent aux « atteintes à la liberté des femmes » prétendument induites par certaines pratiques religieuses. Or, loin de renforcer la liberté, ces textes contribuent à restreindre le champ des possibles pour les femmes musulmanes. Elles sont ainsi prises en étau entre une lecture patriarcale de leur religion et une République qui ne leur laisse pas le choix d’exister autrement que sous condition.
Paradoxalement, l’État multiplie les dispositifs de lutte contre les discriminations… tout en étant à l’origine de nombreuses mesures discriminatoires. C’est ainsi qu’on peut lire dans les propositions parlementaires :
- Proposition 13 : confier à la Miviludes la mission de détecter des « dérives sectaires » dans l’entourage des femmes portant le voile intégral.
- Proposition 14 : considérer le port du voile intégral comme indice de persécution dans les demandes d’asile.
Pendant ce temps, des propositions plus constructives sont rejetées :
- Proposition 7 : création d’une École nationale d’études sur l’islam.
- Proposition 8 : engagement d’un travail parlementaire sur l’islamophobie et les discriminations envers les musulmans.
Ce deux poids deux mesures en dit long sur l’orientation politique dominante : on préfère surveiller et réprimer que comprendre et inclure.
Depuis 2003, les commissions Stasi puis Debré ont servi de caution intellectuelle à des lois qui, sous prétexte de défendre la laïcité, ont instauré une suspicion généralisée à l’égard des citoyens de confession musulmane. Le mot « laïcité » a été vidé de sa substance originelle pour devenir un instrument idéologique. Or, selon la Constitution française elle-même :
- « La France est une République laïque. »
- « Elle respecte toutes les croyances. »
La laïcité, ce n’est pas l’interdiction de croire ni de pratiquer publiquement sa religion. C’est la garantie que l’État ne privilégie ni ne persécute aucune foi. Aujourd’hui, cette promesse constitutionnelle est largement bafouée.
Aujourd’hui,
Aujourd’hui encore, les politiques publiques contribuent à renforcer un sentiment d’exclusion. Lorsqu’une partie de la population a le sentiment d’être jugée non sur ses actes mais sur son appartenance réelle ou supposée, la République ne joue plus son rôle d’arbitre impartial. Si certains s’identifient au combat des Palestiniens, c’est parce qu’ils perçoivent en France un système d’assignation, d’humiliation et de ségrégation, certes plus feutré, mais néanmoins réel.
Demain,
Demain, il appartient à chacun de refuser cet état de fait. Ni la résignation ni l’attente d’un hypothétique changement venu d’en haut ne suffiront. C’est par l’engagement politique, par la prise de parole, par l’accès aux responsabilités que pourra s’amorcer une transformation durable. Ce n’est pas à la République de décider qui mérite d’être représenté ; c’est à chaque citoyen de faire valoir ses droits, ses aspirations, sa dignité.
La vraie question est celle-ci : face à l’injustice, vaut-il mieux agir ou détourner le regard ? L’histoire montre que l’inaction n’a jamais été un refuge durable. Agir, c’est refuser que le principe d’égalité soit réservé à certains. C’est rappeler, sans relâche, que la liberté de conscience n’est pas une faveur mais un droit fondamental.